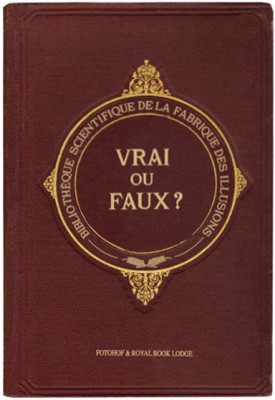VRAI OU FAUX ? Véronique Bourgoin
06/21/2013
Du 1er juin au 1er septembre 2013
Les 25 et 26 juin, de 14h30 à 17h Véronique Bourgoin avec Ursula Panhans-Bühler, Dirk Bakker, Annegien van Doorn, Erik Kessels, Paul Kooiker, Jean-Louis Leibovitch, Bastiaan van der Velden,
vous invite dans le salon «Vrai ou Faux?» autour d’une discussion sur l’Art la photographie et la société.
Et à la signature du livre « Vrai ou Faux? », éditions Fotohof et Royal Book Lodge
Le 1er juin : vernissage avec une performance de Vero Cruz et des Hole Garden
accompagnée d’une improvisation musicale de Reza Azard et Forty Dollar Baby
Présentation du livre Vrai ou Faux, éditions Fotohof et Royal Book Lodge
ACT I avec les oeuvres de Julia Abstädt, Antoine d’Agata, Reza Azard, Bachelot Caron, Véronique Bourgoin, Linda Bilda, Fredi Casco, Joan Fontcuberta, Alberto Garcia Alix, Gelatin, Sara Glaxia, Gudny Gudmundsdóttir, Risk Hazekamp, Les Hole Garden, Alison Jackson, Bruce Kalberg, Adolfo Kaminsky, Erik Kessels, Martin Kippenberger, Paul Kooiker, Lutz Krüger, Jean-Louis Leibovitch, Jérôme Lefdup, Anne Lefebvre, Jochen Lempert, Boris Mikhailov, Judith Rohrmoser, Hank Schmidt in der Beek, Juli Susin, Bastiaan Van der Velden, Les Yes Men.
De la collection ROYAL BOOK LODGE les oeuvres de Abel Auer, Dick Bengtsson, matali crasset, Guy E. Debord, Andy Hope 1930, Daniel Johnston, Dorota Jurczak, Charlet Kugel, Jonathan Meese, Raymond Pettibon, Ralph Rumney, Storwal, Miroslav Tichy.
De la collection du NEDERLANDS FOTOMUSEUM les oeuvres de Violette Cornelius, Bob van Dam / Combipress, Wally Elenbaas, Bernard F. Eilers, Ed van der Elsken, Lucebert, Cas Oorthuys, Peter Martens, Hans Spies, Hannes Wallrafen, Lies Wiegman and Piet Zwart, Bernard F. Eilers avec des interieurs de Amsterdam School Binnenhuis, J.A. Snellebrand et Pieter Vorkink.
ACT II avec les archives de l’ATELIER REFLEXE et les images des résultats des workshops « Vrai ou Faux ? »
Interview de Véronique Bourgoin par Bernard Marcadé
Bernard Marcadé : La publication se présente comme deux volumes, correspondant finalement à vos deux régimes d’activités ?
Véronique Bourgoin : Le premier volume est consacré aux salons privés dans lesquels j’ai installé les «archives du vrai et du faux», archives que nous avons réunies, ainsi que des œuvres d’artistes, connus ou moins connus, dont j’ai choisi les pièces. Le deuxième volume concerne les workshops que nous avons organisés en Europe autour de la question du vrai et du faux.
B.M. : Le premier volume rassemble donc des documents reliés à votre activité d’exposition, au sens classique du terme, alors que le second renvoie à un travail plus expérimental ?
V.B. : L’Atelier Reflexe est un projet que j’ai initié avec Juli Susin, en 1994 autour de la question photographique et artistique, qui s’adresse à des photographes à travers un programme de workshops, d’expositions et de publications et fait intervenir des artistes connus comme Antoine d’Agata, Joan Fontcuberta, Anders Petersen, Boris Mikhaïlov, Gelatin ou d’autres plus en marge…
B.M. : Peut-on dire que vous assumez désormais cette activité de workshop comme une œuvre ?
V.B. : En un sens oui, puisque je lui consacre le deuxième volume de cette publication. Cela prend d’ailleurs la forme d’un journal détourné (en l’occurrence Le Monde) qui mélange toutes les archives collectées ces dernières années et qui amène une réflexion sur notre monde contemporain dans son rapport au vrai et au faux…
B.M. Une manière de faire rebondir, éditorialement, ce qui se passe dans vos installations ?
V.B. : Dans l’installation (qui se constitue de vraies œuvres dans un faux salon), on pourra effectivement consulter ces journaux détournés. J’aimerais que le spectateur fasse partie du décor, qu’il soit dans la position d’un personnage en train de lire un journal sur l’actualité d’aujourd’hui, assis dans un salon poussiéreux… Un espace paradoxal où l’on aurait l’impression que le temps ralentit, comme dans le salon d’un vaisseau spatial traversant l’univers à la vitesse de la lumière, meublé dans le style de l’époque où l’on commençait à rêver de ces voyages impossibles à travers les dimensions, où l’on y projetait un futur fantastique. Je parle des années 1915 à 1930, des romans de Pawlowski, de Raymond Roussel, du mobilier Rondo-cubiste ou des expressionnistes hollandais (je pense surtout au mobilier de Michel Klerk, «poète de l’étincelante nouveauté», un utopiste à la fois attaché au culte de la construction, qui mêlait savamment science et art). Ses salons sont d’ailleurs présentés dans l’installation au Foto Museum de Rotterdam. Le livre comme les installations montrent, à la façon d’un travelling, ce passage à travers ces espaces intermédiaires où la relation entre le vrai et le faux devient plus ambiguë et plus complice… comme un voyage dans le temps où l’on récolte des bribes d’histoire entre les visions écrasées par la courte focale d’un observateur éloigné de nous par des millions d’années et celles, plus organiques, face à l’espace infini…
B.M. : Les textes et les images ont manifestement un point commun ?
V.B. : Oui, ils reflètent la violence sourde qui est au cœur de nos sociétés contemporaines, dissimulée derrière les iconographies et les références produites par la «fantaisie» officielle. La violence aujourd’hui est sournoise, déguisée, mais elle est beaucoup plus terrifiante que la violence ordinaire (celle de la guerre, par exemple), sur laquelle il est facile de compatir. Cela part d’un questionnement sur l’effacement de plus en plus grand aujourd’hui des frontières entre le vrai et le faux. C’est cette dimension qui est apparue dans tous les workshops que j’ai organisés, au cours desquels j’ai essayé de préciser ces idées par l’association avec les images collectées. Ce questionnement pointe l’importance de la lecture et du regard, dans une époque où l’on pense de plus en plus avec des images qui se succèdent, comme des annonces publicitaires, dans la grande salle de cinéma qu’est devenue l’intérieur de notre cerveau…
B.M. : Dans quel contexte, organisez-vous ces workshops ?
V.B. : C’est variable, mais toujours en relation avec des partenaires. Nous ne sommes pas, à proprement parler, une institution. Ces ateliers sont nomades. Ils peuvent se dérouler dans mon espace de Montreuil-sous-Bois, comme à l’étranger. En Grèce, c’est en partenariat avec le Photography Museum of Thessaloniki, en Lettonie avec l’International Summer School of Photography, en Turquie avec l’IFSAK, ou en France avec Le Bal, La Maison Populaire, Les Instants Chavirés… Chaque questionnement est relié à une vision actuelle. Il est très important de se confronter vraiment à la société réelle dans laquelle nous vivons. C’est comme un miroir qui reflète l’autre côté du miroir, faisant apparaître ce qui ne se voit pas directement.
B.M. : Quelle en est la ligne directrice ?
V.B. : Plus qu’une école, ce serait plutôt un projet d’expéri- mentation libre autour de la photographie. Cela a commencé d’une façon informelle, et petit à petit, ça s’est développé ; au fil du temps nous avons constitué une «constellation» avec un noyau dur de stagiaires et des intervenants réguliers…
B.M. : Vous êtes partie d’une réflexion autour de la photographie, mais ce champ s’est lui-même ouvert ? V.B. : A l’origine, mon expérience photographique est liée à la peinture. Je ne suis pas très à l’aise dans la photographie «volée» ou documentaire. Pour moi la photographie a toujours été un médium qui permet de révéler la réalité, plutôt que de la découper en tranches plus ou moins fines… Même si le terme «révéler», qui correspondait si bien à l’époque analogique et chimique, devient une métaphore obsolète au temps des imprimantes jet d’encre, avec une connotation purement mystique. J’ai toujours eu besoin de temps pour «regarder», pour voir l’image apparaître…J’ai besoin de temps aussi pour créer une complicité avec le modèle…
B.M. : Le modèle ? De quel modèle s’agit-il ?
V.B. : Le modèle, c’est l’élément, vivant ou inerte, une personne, une créature, un animal, un arbre, une chambre, une rue, qui vont se métamorphoser en œuvre… J’aime voir évoluer les éléments familiers de mon quotidien dans des situations décalées, qui ouvrent des espaces «métaphysiques». A la manière des surréalistes, quand la signification de départ finit par m’échapper, le titre réajuste le sens pour chacune des images ou séries. J’ai d’ailleurs créé un groupe, les Hole Garden, comme prolongement animé de mes images. Avec ce groupe, j’essaye d’investir le «concept» de la femme
occidentale fabriquée en Chine… Ce sont des vidéos où les icônes occidentales sont confrontées à la manufacture chinoise…
B.M. : Revenons à vos « vraies œuvres » dans votre « faux salon »…
V.B. : On pourrait renverser la proposition. En fait il s’agis- sait au départ d’un vrai salon, le mien, dans lequel j’ai ima- giné d’installer des œuvres. Puis, ce salon est devenu trans- portable… A la manière de la «Boîte en valise» de Marcel Duchamp… Le salon est devenu «faux» de ce fait. Et les œuvres sont devenues réelles…
B.M. : Ces œuvres que vous installez dans vos salons nomades sont des choix personnels ?
V.B. : Je me suis d’abord cantonnée à la famille d’artistes qui côtoyait mon salon, dans la tradition de la fin du XIXe siècle… Puis, j’ai précisé mes choix avec des artistes impliqués par la question du vrai et du faux, comme Joan Fontcuberta, par exemple. J’ai dégagé au fur et à mesure, des thématiques : la falsification de l’Histoire, la contrefaçon, la valeur sociale, le mimétisme, le plagiat, le clonage… L’exemple de Martin Kippenberger est très éclairant, de ce point de vue. Il était obsédé par la figure de William Holden. Physiquement, il s’identifiait à lui, jusqu’à envoyer d’Afrique (lieu de la fondation W.H.) une série de cartes postales signées William Holden Company… Il anticipait, à sa manière (très artistique!) l’appropriation actuelle de l’identité comme on peut la voir sur Facebook…
B.M. : Vous intégrez également des documents « non-artistiques » ?
V.B. : Dans chacune de ces catégories, on peut mettre en relation des œuvres avec des objets documentaires. Par exemple des photographies retouchées de criminel parues dans le Petit Parisien des années 20-40, des briquets chinois à l’effigie de la Joconde…
B.M. : Cette méthode est également en jeu dans votre journal détour- né ?
V.B. : Le journal implique la notion de «Rubriques». Prenez par exemple une rubrique «Mode et conflits» dans laquelle j’associe des images de guerre avec des documents qui montrent la récupération de l’esthétique guerrière ou terroriste dans les défilés de mode Prada ou chez Galliano où l’on a pu voir un condamné cagoulé, en slip, flagellé et la corde au cou.
B.M. : Cela nous ramène à cette sourde violence que vous évoquiez ?
V.B. : La vraie guerre apparaît plus comme un show hollywoodien, alors que les shows eux-mêmes édulcorent cette violence, en la détournant. Le résultat est une banalisation de la violence. Le fait d’installer ces images et documents, dans un contexte finalement domestique, signifie que cette violence s’est partout infiltrée dans notre quotidien, de la façon la plus insidieuse et la plus «normale» qui soit.
B.M. Je vois bien là votre rapport très fort à la pensée situationniste ?
V.B. : Les situationnistes se sont servis de méthodes spectaculaires pour combattre le Spectacle, comme le pouvoir moderne a fait, avant eux, pour combattre les révolutions. Après la description du monde de la falsification faite par Guy Debord dans sa Société du Spectacle, ils ont utilisé eux même la technologie du leurre comme une arme subversive. Je pense au fameux livre écrit par Gianfranco Sanguinetti sous le pseudonyme «Censor». Ce «Faux» de Sanguinetti a fait scandale en Italie, en dénonçant sous une identité masquée le spectacle du faux terrorisme pratiqué impunément par le pouvoir en place contre la population ou certains de ses représentants de «l’époque» et provoquant ainsi désordre et confusion dans l’élite au pouvoir. Plus d’un siècle en arrière, les pamphlets de Paul Louis Courier
démontraient cette même insoumission. Je pense aussi à Adolfo Kaminsky, un autre grand expert en Faux, qui a développé une technologie de falsification infaillible, non pas pour «sauver le monde», mais pour sauver la vie de milliers de gens. En fabriquant pendant 30 ans, sans tapage, dans une clandestinité absolue, des «faux papiers», en s’engageant dans la Résistance pendant la seconde guerre, auprès du FLN en Algérie, en s’opposant à la dictature en Espagne… Il me semble que beaucoup de contributions décisives des situationnistes se situent aussi avant 1963, quand il leur était encore permis d’être artistes. Je suis loin d’adhérer au fait que Debord ait finalement exclu les artistes au nom des principes révolutionnaires. Même si cette pensée est effectivement importante et décisive pour comprendre notre monde, je me sens beaucoup plus proche de celle d’Annie Le Brun. Avec cette course à la rationalisation, l’emprise grandissante de la technologie, l’univers du simulacre, le corps immatériel, on assiste à la disparition de l’imaginaire et du corps comme laboratoire et espace infini, et à une même époque où l’on détruit des forets entières pour y planter des maïs transgéniques, dans notre esprit s’encodent les repères numériques, l’univers sensible est balisé par un «ratissage» forcené de la «forêt mentale», comme l’exprime parfaitement Annie Le Brun.
Texte de Ursula Panhans-Bühler
VRAI OU FAUX ? un point d’interrogation artistique derrière les paradis de l’innocence contemporains
Chacune des installations réalisées par Véronique Bourgoin au cours des trois dernières années dans différentes villes d’Europe – Hambourg, Vienne, Arles, Istanbul et Rotterdam qui sera sa prochaine étape en juin 2013 – plonge le visiteur dans une situation de réflexion onirique. L’effet de trompe l’œil produit par les photos en noir et blanc qui tapissent les murs des espaces réels des galeries, du sol presque jusqu’au plafond, nous précipite dans des décors d’intérieurs du 19e siècle ou de la période Art Nouveau, flash-back nostalgique dans l’atmosphère chargée d’un mobilier rococo, d’épais tapis et de pesants rideaux, de murs ornés de portraits et de scènes mythologiques. S’il s’agissait d’une vraie demeure privée de ces temps anciens, transformée en musée et ouverte au public par exemple, nous éprouverions sans doute le sentiment étrange et fascinant d’être illusoirement transportés pour la durée de notre séjour dans une époque qui n’est plus la nôtre. Si nous tenions les photos de ces pièces dans nos mains ou les regardions dans un livre, notre curiosité voyeuriste ou esthétique s’accommoderait sans doute sans problème de la représentation photographique, déplorant tout au plus l’absence de couleurs dans le cas de photos en noir et blanc. Hier et aujourd’hui demeureraient clairement distincts.
Mais les choses en vont tout autrement dans les installations de Véronique Bourgoin. Ici, les murs tapissés de photos semblent s’intercaler entre l’observateur que nous sommes et le lieu réel dans lequel nous nous trouvons. Le trompe l’œil ne traverse pas seulement de manière illusoire les murs couverts de photographies; il nous transporte plutôt tout à la fois dans un certain état d’être et de ne pas être là. En état de choc comme au temps de la naissance de la photographie, quand l’incolore «pinceau de la nature» venait étrangement effleurer les observateurs et leur suggérer une existence brumeuse et fugitive, nous sommes ici transportés dans un état qui touche à notre rapport à nous-mêmes. Car le trompe l’œil n’articule pas seulement la tension d’un lointain espace inaccessible, mais aussi, par le biais du noir et blanc, une dimension temporelle inquiétante puisqu’elle pose la question du rapport à notre propre souvenir originel. Les murs tapissés de photos viennent qui plus est ironiquement – comme des tirs de harcèlement dispersés – lester cette expérience insolite, photos épinglées, tableaux et petits objets issus de l’art, sans référence à quelque critère de valeur marchande, et de la sphère triviale de notre propre époque, dont le statut d’objets tangibles est renforcé par leur aspect fréquemment coloré.
Véronique Bourgoin a formulé dans un constat à la fois impressionnant et alarmant le problème de la disparition de la troisième dimension dans le lien à notre propre histoire dont relève la question du rapport entre vrai et faux : «Vrai ou Faux ? La frontière entre l’un et l’autre n’est plus un axe fixe, un axe vertical et vertigineux, que l’art a toujours su transgresser sans filet. Le ‘Vrai et le Faux’ se confondent dans cette horizonta- lité sans fin d’un paysage sans ombre où la réalité ne s’oppose à rien ni à personne.» (Citation en français dans le texte). Il n’est par conséquent pas indifférent que les espaces ‘installés’ par l’artiste se présentent comme des salons, des intérieurs. En tant que médium, ils véhiculent le report à la question de l’axe intérieur du sujet, du monde en nous, cependant que, par asso- ciation, les œuvres et les artefacts de notre quotidien qui y sont intégrés élargissent cette dimension. La question du « Vrai ou Faux » ne s’épuise donc pas dans un jeu banal de décisions où chacun peut faire son choix, comme y convient les requêtes des sites internet avec leurs manipulations par clics «like-it» ou leur omission, les quotas d’audience et illusions d’appartenance. Les salons «Vrai ou Faux», chaque fois conçus pour des lieux spé- cifiques, créent au contraire des situations qui nous touchent et qui remettent en question, à la fois précautionneusement et de manière pressante, la fuite culturelle hors de l’axe vertical ambi- valent et émotionnellement inquiétant dans la banalité d’un axe horizontal en apparence paisible et apaisant. Ils sont en quelque sorte une opportunité d’appréhender l’étrange complicité entre le public et les consommateurs d’une part, les médias, la publi- cité, la politique et la science instrumentalisée de l’autre, un commerce des âmes accepté par tous parce qu’il peut permettre d’échapper à la pression du feu ardent réprimé d’une peau de chagrin autodestructrice.
La voie nomade des Salons – nulle part durablement établis – s’accompagnera d’ateliers dans les différentes stations où l’archive de la «Fabrique des Illusions», des artistes invités, ainsi que des participants impliqués avec leurs propres expériences et observations se poseront la question du «Vrai ou Faux» au cours de débats et des études photographiques. Dans ces ateliers, la différence entre Vrai ou Faux finit toujours par se dissiper. Les résultats concrets, complétés d’éléments d’archives collectés au fil des ans par Véronique Bourgoin elle-même, sont ensuite présentés dans une sorte de «cabinet de curiosités», intégré selon les cas dans les salons ou les différentes localités. Ici se révèle de manière satiriquement drastique l’univers de l’ersatz, passion unique de l’économie et de ses complices, perpetuum mobile de la satisfaction d’un assouvissement des envies insinué ou halluciné sous le masque du désir, ou si l’on veut un retour insolite de l’anthropophagie qui, dans le «Trop de réalité», pour renvoyer au titre d’un livre d’Annie Le Brun, enferme toute différence entre le vrai et le faux dans un circuit fermé du désir. À l’invisible et sournoise violence qui règne dans les zones en apparence paisibles de notre monde, une complicité entre le kitsch visible et la mort – dans un premier temps invisible -, s’ajoute de manière impressionnante dans ce cabinet de curiosités le zapping schizophrénique suscité par un mur vidéo scintillant, composé de vieux boitiers de téléviseurs qui diffusent un choix en apparence arbitraire de films et vidéos qui font éprouver à l’observateur sa perte de contrôle et de concentration. Nous sommes ici dans un Musée de l’Homme d’un nouveau genre, dans lequel l’«Obsolescence de l’homme», titre et sujet d’un livre de Günter Anders, a redoutablement et cyniquement progressé sans que quiconque y trouve à redire. Transformée en clones, robots, avatars et répliques, la poupée de l’«Eve future» du 19e siècle n’est pas seulement devenue l’idéal d’un être artificiel des deux sexes libéré de la honte d’un physique impur, la fin d’une singularité humaine dans l’idole. Sa véritable métamorphose en poupée lui a emboîté le pas comme permettent de le constater les foisonnants exemples de Barbie et de Ken. «Vrai ou Faux ?», l’ère du désir des métamorphoses heureuses a conduit à une ère de mutations, à un étrange ‘mysterium conjunctionis’ d’instincts pulsionnels et de technique.
Mais le concept artistique de Véronique Bourgoin ne se situe pas seulement dans l’espace historique ; l’artiste compte des alliés dans l’histoire et dans l’art. Elle partage par exemple avec Aby Warburg un intérêt pour Mnémosyne, la muse du souvenir dont sont tributaires toutes les autres muses qui assistent les actions productrices de l’humanité. Si les muses n’ont pas d’adversaires directs, les Erynies ou Furies, elles, endossent le rôle de destructrices des dons artistiques, jusqu’à la perte de mémoire quelquefois lorsqu’elles parviennent à leur fin. Mais Mnémosyne, la muse du souvenir, peut aussi, quant à elle, être regardée comme une figure qui accompagne spirituellement toutes les activités et expériences humaines. Rien ne se perd, même si cela demeure refoulé. L’axe vertical dont parle Véronique Bourgoin, est constamment en mouvement et son processus quant au «Vrai ou Faux» est mis au défi par des artistes «sans filet» dans de vertigineux forages en profondeur. Aby Warburg avait parlé des ‘Pathosformel’ (formules de pathos) du désir, qui, dans notre histoire européenne depuis l’antiquité, se seraient retransmises dans des figures mythologiques et les récits connexes. Ses recherches sont recensées dans l’archive de son Atlas Mnémosyne, des tableaux iconographiques qui traquent le champ et le mouvement des motifs dans la réserve des pulsions humaines, accompagnés pour chaque domaine thématique de formules-clés de Warburg lui-même ou d’essais explicatifs de ses collaborateurs.
Pour Warburg, la Nymphe était une figure déterminante du retour de l’agrément du désir à la Renaissance. Mais comme dotée d’une double nature, la Nymphe était aussi susceptible à tout instant de se métamorphoser en Ménade et de devenir une figure convulsive de l’ambivalence du désir. Le diagnostic critique de Véronique Bourgoin, la rupture de l’axe vertical du souvenir passionné dans une unité sourde et indifférenciée formule la fin de la Mnémosyne dans le sens que lui donnait Warburg. Mais dans une perspective culturelle et avec la complicité des artistes invités et des participants aux ateliers, elle met en question cette fin et tend en quelque sorte vers une réactualisation des recherches entreprises par Warburg, afin de soustraire tout fondement à la scission thermiquement catastrophique de l’ambiguïté du désir. L’effroi de la vérité de cette pratique n’est pas dissipé mais encore présent dans la falsification du «Trop de réalité», fût-il nié ou rendu invisible.
Nous ajouterons une remarque encore quant à la forme de la présentation. Les photos de Warburg étaient montées sur des planches de papier photographique noir. Dans un grand nombre de ses installations, Véronique Bourgoin joue sur le clair-obscur de la situation d’intérieur, parfois avec les ombres portées du contre-jour sur les murs. Les ombres prennent ainsi une part créatrice à l’incarnation de la lumière et par conséquent à une issue possible pour les captifs de la caverne de Platon. Dans les deux cas, chez Aby Warburg comme chez Véronique Bourgoin, il serait permis de parler d’une clairvoyante mélancolie, historiquement clairvoyante au regard de l’histoire du désir dont ils traitent l’un et l’autre et dans laquelle ils aspirent à intervenir productivement avec leur travail.
Mais cette clairvoyance mélancolique devenue forme rapproche aussi l’œuvre de Véronique Bourgoin de celle de Marcel Broodthaers et de son fictif «Musée de l’art Moderne, département des Aigles». Broodthaers constitua lui aussi des archives, d’aigles par exemple – de fait le seul département de son musée, réparti en plusieurs sections distinctes. «O Mélancolie / Aigre château des Aigles», ce concetto aux apparences de Haiku décrit la mélancolie individuellement butée que de nombreux artistes conjuguent, selon lui, avec une pathologie partagée par l’homme du quotidien d’aujourd’hui et que l’on nomme plus indifféremment «dépression». Il est clair que seul celui qui a connaissance de cela en soi peut le saisir dans cette forme brève du concetto, tout en le traquant, en tant que «porteur d’ombre», dans son œuvre artistique au lieu de le cultiver, et cela parce qu’il sait qu’une telle quête est une fuite devant l’ambiguïté du désir dans un ersatz de satisfaction narcissique.
Au-delà, un autre point commun rapproche Véronique Bourgoin et Marcel Broodthaers : la connexion entre le 19e et le 20e siècle et entre le 20e – en tout cas situé pour Broodthaers à l’horizon du processus d’une culture du décor – et le 21e siècle. Broodthaers voulait saper la prétention de l’art moderne et contemporain, depuis les années 60, à s’affirmer comme bonne conscience d’une avant-garde qui allait soudain s’établir historiquement comme le pilier culturel de son époque par opposition à l’historisme bourgeois du 19e siècle. L’art moderne prolongeait à ses yeux depuis longtemps ce qui était la vérité de l’historisme du 19e siècle, un «décor» – qui escamotait les rapports. D’où sa vision d’un art empêtré dans un jeu dangereux avec le pouvoir – l’Aigle, ce qui allait se vérifier, si l’on songe à l’instrumentalisation médiale de l’art comme masquage culturel des rapports, succédant aux idées exemplaires de carrières de plongeurs en cuisine de la première moitié de l’ère économique américaine en particulier. Broodthaers parlait d’«un monde en danger», et c’est autour de ce thème que tournaient toutes ses «situations», comme il nommait lui-même ses espaces, pour éviter le terme suspect à ses yeux d’«installation».
La «Raumgreifende Installation», comme la désigne l’alle- mand, parle du reste une langue précaire qui réveille des souve- nirs. Broodthaers retrouverait très certainement comme pronos- tic dans ses propres questionnements artistiques la thématique de Véronique Bourgoin de l’abandon de l’axe des souvenirs douloureux en faveur d’une tolérance opportuniste à l’égard de tout et chacun, et le commenterait avec un humour noir chargé d’espérance.
Dans cette idée d’affinité avec Mnémosyne, je proposerais d’inclure aussi les «Histoire(s) du cinéma» de Jean-Luc Godard. Cette œuvre de philosophie historique et esthétique relève également du principe de l’archivage avec ses séquences filmiques, ses fragments empruntés à la littérature et à la poésie, à la philosophie, à des citations musicales, l’insertion de reproductions photographiques de l’histoire de la peinture et de la sculpture, concentrée sur le 19e siècle français moderne, avec même quelques retours en arrière à Goya et à la peinture de la Renaissance, et jusqu’au relief d’un chapiteau du premier art roman français. Les nombreuses Histoires ne livrent pas une seule histoire et c’est peut-être en cela que réside, si l’on veut, la dimension anarchique productive de cette série de vidéos. Godard diagnostique la fin du cinéma comme forme sociale, vaincu dans la confrontation avec la télévision et la vidéo. La technique vidéo lui avait pourtant permis un extraordinaire mélange de matériaux artistiques et documentaires, une sorte de conjuration pour ne pas renoncer aux espoirs d’une rencontre spéculaire avec sa propre aspiration, en dépit même du revirement catastrophique des vœux et des événements au cours du 20e siècle.
Lors de la présentation de ses Histoire(s) du Cinéma à Cannes en 1997, Godard avait tiré de sa poche et lut un papier sur lequel il avait noté une phrase reproduite dans le journal de Hollis Frampton, le réalisateur de films de l’avant-garde américaine qui venait de décéder. Elle disait à peu près ceci : Toute époque artistique ébauche, à partir des souvenirs du passé, l’idée d’un futur meilleur. C’était au fond comme si Godard décrivait son propre travail. Et c’est aussi ce qui crée un lien avec le projet de Véronique Bourgoin. Même dans le 19e siècle fétichiste falsifié, on distingue encore la trace du double sens, dans le conflit du désir, du «vrai» qui accompagne l’historisme romantique. C’est seulement le «faux» souhaité, la conclusion unidimensionnelle de toute ambivalence, qui pousse au paradis actuel de l’innocence comme la tempête qui, à partir de là, s’engouffre dans les ailes de l’ange de l’Histoire, l’empêchant de rassembler et recomposer les décombres de l’Histoire, comme l’a décrit Walter Benjamin. Ces ailes, le génie de la série des gouaches «La Dame de Clelles» de Véronique Bourgoin qui, sans que cela soit dit, est présente dans ses Salons, les a repliées avec la mélancolie de celui qui sait. Mais ses vêtements, qui évoquent les losanges de l’habit de clown, et son factotum bardé de blanc, sont aussi un écho humoristique et discret au couple du clown blanc mélancolique et de l’Auguste impertinent, même si les rôles sont ici inversés. Ainsi ne sera-t-on pas surpris de voir dans «La Dame de Clelles» une discrète référence à la muse Mnémosyne, empreinte d’une vive attention mélancolique.